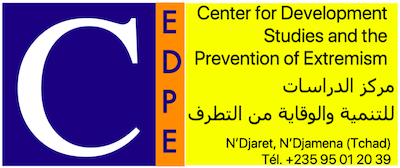Date : 10/06/2025
Réf : CEDPE/PR/CC/214-1256/2025
Contact : 65031560 – watsup : 99860817
0033772438986
Objet : Table ronde sur le thème « Polycrise en Afrique francophone : La sécurité climatique et environnementale »
mardi 10 juin de 9h30 à 11h30 (heure de Paris) au siège de l’OIF
Communication du Dr. Ahmat Yacoub Dabio
Président du CEDPE
Sur le nexus-climat-la migration-le stress hydrique et les conflits avec un focus sur l’Afrique centrale.
Mesdames et Messieurs, chers experts,
Permettez-moi, tout d’abord, d’exprimer ma profonde gratitude à l’Organisation internationale de la Francophonie notamment la Direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique (DAPG), qui déploie des efforts considérables pour organiser des événements permettant aux experts que vous êtes d’échanger sur des thématiques d’une importance capitale.
Je tiens également à adresser mes sincères remerciements et salutations à toutes celles et ceux qui, malgré leurs nombreuses responsabilités, ont accordé à cette conférence l’attention qu’elle mérite. Bonjour aux experts ici présents de l’OIF, de FrancoPaix, du CEDPE, du Consortium, de Thinking Africa et tous les autres.
Mon intervention va s’articuler autour d’un sujet d’une importance capitale : le nexus climat, migration-le stress hydrique et les conflits, avec un focus sur l’Afrique centrale. C'est en quelque sorte un état des lieux de la problématique, avec un focus sur l'Afrique centrale, pour finir avec quelques recommandations. Je tiens à préciser que nous avons eu l'honneur de travailler avec l'OIF sur un projet d'étude en deux phases entre 2022 et 2024, engageant plus de 3000 personnes sur le terrain, avec la production d’un rapport exceptionnel, en cours d'édition.
Le changement climatique faut-il le rappeler entraine des impacts significatifs, tels que l’augmentation des températures, des variations des régimes de précipitations et la dégradation des terres. Ces changements conduisent à un stress hydrique croissant affectant la disponibilité des ressources essentielles pour les communautés locales. Par conséquent, nous assistons à des mouvements migratoires importants, souvent motivés par la recherche des meilleures conditions de vie et des ressources. Mais cependant cette migration peut engendrer des tensions et des conflits, souvent exacerbés par une compétition pour des ressources déjà limitées. .
Comment le changement climatique interagit-il avec les dimensions de la sécurité et de l'environnement en Afrique centrale ?
Il est donc urgent d’analyser comment ces facteurs interagissent et de trouver des solutions durables pour garantir la paix et la sécurité dans cette région.
Réf : CEDPE/PR/CC/214-1256/2025
Contact : 65031560 – watsup : 99860817
0033772438986
Objet : Table ronde sur le thème « Polycrise en Afrique francophone : La sécurité climatique et environnementale »
mardi 10 juin de 9h30 à 11h30 (heure de Paris) au siège de l’OIF
Communication du Dr. Ahmat Yacoub Dabio
Président du CEDPE
Sur le nexus-climat-la migration-le stress hydrique et les conflits avec un focus sur l’Afrique centrale.
Mesdames et Messieurs, chers experts,
Permettez-moi, tout d’abord, d’exprimer ma profonde gratitude à l’Organisation internationale de la Francophonie notamment la Direction des affaires politiques et de la gouvernance démocratique (DAPG), qui déploie des efforts considérables pour organiser des événements permettant aux experts que vous êtes d’échanger sur des thématiques d’une importance capitale.
Je tiens également à adresser mes sincères remerciements et salutations à toutes celles et ceux qui, malgré leurs nombreuses responsabilités, ont accordé à cette conférence l’attention qu’elle mérite. Bonjour aux experts ici présents de l’OIF, de FrancoPaix, du CEDPE, du Consortium, de Thinking Africa et tous les autres.
Mon intervention va s’articuler autour d’un sujet d’une importance capitale : le nexus climat, migration-le stress hydrique et les conflits, avec un focus sur l’Afrique centrale. C'est en quelque sorte un état des lieux de la problématique, avec un focus sur l'Afrique centrale, pour finir avec quelques recommandations. Je tiens à préciser que nous avons eu l'honneur de travailler avec l'OIF sur un projet d'étude en deux phases entre 2022 et 2024, engageant plus de 3000 personnes sur le terrain, avec la production d’un rapport exceptionnel, en cours d'édition.
Le changement climatique faut-il le rappeler entraine des impacts significatifs, tels que l’augmentation des températures, des variations des régimes de précipitations et la dégradation des terres. Ces changements conduisent à un stress hydrique croissant affectant la disponibilité des ressources essentielles pour les communautés locales. Par conséquent, nous assistons à des mouvements migratoires importants, souvent motivés par la recherche des meilleures conditions de vie et des ressources. Mais cependant cette migration peut engendrer des tensions et des conflits, souvent exacerbés par une compétition pour des ressources déjà limitées. .
Comment le changement climatique interagit-il avec les dimensions de la sécurité et de l'environnement en Afrique centrale ?
Il est donc urgent d’analyser comment ces facteurs interagissent et de trouver des solutions durables pour garantir la paix et la sécurité dans cette région.
- Le changement climatique comme facteur de migration
Les crises climatiques et environnementales ont un impact sur les mouvements humains, tant à l'intérieur des pays étudiés qu'au-delà des frontières. Ces migrations climatiques ont pris de nombreuses formes : forcées et volontaires, temporaires et permanentes, internes et internationales[[1]]url:#_ftn1 . La très forte croissance démographique de l'Afrique centrale, la faiblesse de la gestion des ressources naturelles et l'impact du changement climatique ont exercé une pression considérable sur les moyens de subsistance des populations, entraînant entre autres une grande mobilité des populations[[2]]url:#_ftn2 .
Les changements dans les schémas migratoires, dus à l'impact des crises climatiques, entraînent une raréfaction des ressources disponibles, poussent les éleveurs à pénétrer plus profondément dans les zones traditionnellement dominées par les communautés agricoles[[3]]url:#_ftn3 .
En raison de la fréquence accrue des conflits liés à la transhumance (conflits d'usage du sol, accès aux pâturages, conflits culturels, etc.), de plus en plus d'agriculteurs et d'éleveurs sont lourdement armés, ce qui rend les conflits entre les deux communautés de plus en plus meurtriers. Ces facteurs ont agi profondément sur les pratiques agricoles et pastorales : augmentation des surfaces cultivées en lieu et place des anciens pâturages, descentes massives des éleveurs transhumants de la zone septentrionale vers le sud et nouvelles formes de mobilité des troupeaux pour s’adapter à la forte inégalité spatio-temporelle des ressources pastorales et hydriques[[4]]url:#_ftn4 .
Le changement climatique a donc constitué dans ces trois pays non seulement un terreau assez fertile pour l’émergence des conflits entre agriculteurs et éleveurs mais a contribué aussi de façon considérable à leur prolifération.
Les changements dans les schémas migratoires, dus à l'impact des crises climatiques, entraînent une raréfaction des ressources disponibles, poussent les éleveurs à pénétrer plus profondément dans les zones traditionnellement dominées par les communautés agricoles[[3]]url:#_ftn3 .
En raison de la fréquence accrue des conflits liés à la transhumance (conflits d'usage du sol, accès aux pâturages, conflits culturels, etc.), de plus en plus d'agriculteurs et d'éleveurs sont lourdement armés, ce qui rend les conflits entre les deux communautés de plus en plus meurtriers. Ces facteurs ont agi profondément sur les pratiques agricoles et pastorales : augmentation des surfaces cultivées en lieu et place des anciens pâturages, descentes massives des éleveurs transhumants de la zone septentrionale vers le sud et nouvelles formes de mobilité des troupeaux pour s’adapter à la forte inégalité spatio-temporelle des ressources pastorales et hydriques[[4]]url:#_ftn4 .
Le changement climatique a donc constitué dans ces trois pays non seulement un terreau assez fertile pour l’émergence des conflits entre agriculteurs et éleveurs mais a contribué aussi de façon considérable à leur prolifération.
- Conflits autour de la gestion des ressources en eau disponibles
La crise climatique et environnementale exacerbe la compétition pour les ressources, notamment l’eau et les espaces de pâturage. La lutte pour les ressources en eau entre les résidents autochtones et les nouveaux arrivants est l'une des principales causes des conflits.
Cela constitue un signe clair de l'impact de la pénurie de ressources en eau (notamment le dessèchement du lac Tchad en raison des changements climatiques) sur l'augmentation des conflits dans les régions étudiées, notamment en raison des intérêts divergents des éleveurs par rapport aux ambitions et aux besoins des agriculteurs.
Il est à noter que le manque de sources d'eau propres et durables, notamment au Tchad et en RCA, menace la sécurité humaine. Cela constitue également un problème grave qui pourrait engendrer davantage de conflits entre les populations pour le contrôle des sources d'eau propres et sûres, ou provoquer des conflits armés entre les habitants et les autorités locales en raison d'un sentiment croissant de marginalisation par les gouvernements nationaux et du manque de services tels que l'eau potable ou l'assainissement.
Insécurité alimentaire
Selon le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) dans un rapport publié cette semaine, près de 29 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire et de protection au Sahel. L'étude porte sur le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger, ainsi que l'extrême nord du Cameroun et le nord-est du Nigeria.
Cela constitue un signe clair de l'impact de la pénurie de ressources en eau (notamment le dessèchement du lac Tchad en raison des changements climatiques) sur l'augmentation des conflits dans les régions étudiées, notamment en raison des intérêts divergents des éleveurs par rapport aux ambitions et aux besoins des agriculteurs.
Il est à noter que le manque de sources d'eau propres et durables, notamment au Tchad et en RCA, menace la sécurité humaine. Cela constitue également un problème grave qui pourrait engendrer davantage de conflits entre les populations pour le contrôle des sources d'eau propres et sûres, ou provoquer des conflits armés entre les habitants et les autorités locales en raison d'un sentiment croissant de marginalisation par les gouvernements nationaux et du manque de services tels que l'eau potable ou l'assainissement.
Insécurité alimentaire
Selon le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) dans un rapport publié cette semaine, près de 29 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire et de protection au Sahel. L'étude porte sur le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger, ainsi que l'extrême nord du Cameroun et le nord-est du Nigeria.
- Quelques recommandations
- Renforcer la coopération régionale
Établir et soutenir des plateformes régionales de coopération : créer des mécanismes formels pour la gestion des ressources transfrontalières, la résolution des conflits liés aux ressources naturelles et la réponse coordonnée aux crises environnementales. Encourager les dialogues réguliers entre les États, les organisations régionales et les communautés locales. Une coopération renforcée facilite la gestion des ressources partagées et permet une réponse coordonnée aux défis climatiques et sécuritaires, réduisant ainsi les risques de conflits transfrontaliers.
2. Accroître la résilience climatique
Développer des programmes de résilience climatique : mettre en œuvre des projets visant à améliorer la résilience des communautés face aux impacts du changement climatique, tels que la construction d'infrastructures résilientes, la promotion de pratiques agricoles durables, et l’amélioration des systèmes d’alerte précoce. Renforcer la résilience des communautés permet de mieux faire face aux impacts des changements climatiques, de réduire les risques de conflits liés aux ressources et de protéger les moyens de subsistance locaux.
3. Promouvoir une gestion intégrée des ressources
Élaborer et appliquer des politiques de gestion intégrée des ressources naturelles : Adopter des approches de gestion durable qui équilibrent les besoins des différents groupes tout en minimisant les conflits et les impacts environnementaux. Encourager des pratiques telles que l’agroforesterie, le travail du sol de conservation et l’agriculture biologique. Une gestion intégrée permet de prévenir les conflits liés aux ressources en tenant compte des besoins de tous les acteurs et en assurant une utilisation durable des ressources naturelles.
4. Augmenter le financement pour l’environnement
Réallouer des ressources financières vers des projets environnementaux et de gestion des conflits : prioriser le financement des initiatives environnementales et de gestion des risques plutôt que les dépenses militaires. Explorer des opportunités de financement international et de partenariats pour soutenir ces projets. L’allocation de ressources financières aux projets environnementaux contribue à la prévention et à l’atténuation des crises liées aux changements climatiques et à réduire les tensions.
5. Renforcer les infrastructures
Il faudrait mettre en place des réseaux d'eau potable capables de résister aux divers phénomènes climatiques tels que les températures élevées, les inondations et les crues, tout en coordonnant cette action avec les communautés locales, y compris les éleveurs.
6. Il faut des projets de reforestation et de gestion des ressources en eau pour aider à stabiliser l'environnement et s’adapter au changement climatique.
6. Il faut des projets de reforestation et de gestion des ressources en eau pour aider à stabiliser l'environnement et s’adapter au changement climatique.
7. Renforcer les mécanismes de lutte contre la corruption et la promotion des valeurs démocratiques pour orienter l’argent vers l’amélioration de la sécurité alimentaire.
Enfin, avec la politique versatile du président Trump, il est impératif de solliciter l'Union européenne, des pays comme le Canada et les pays du Golfe.
Conclusion
Les crises liées à l'eau, comme la sécheresse ou les inondations, incitent les populations à se déplacer vers d'autres régions pour mieux vivre. Cela peut provoquer des déplacements internes ou des migrations transfrontalières, avec des conséquences socioéconomiques et politiques.
La promotion de la coopération régionale sur la gestion des ressources en eau, l'amélioration de la gouvernance et l'investissement dans des infrastructures durables revêtent une grande importance. Pour atténuer les impacts, il est essentiel d'adopter des approches intégrées qui prennent en compte le lien entre le climat, la migration et la sécurité.
Enfin, nous appelons les partenaires étatiques et non étatiques à soutenir l’élargissement, l’approfondissement et l’amélioration de l’enquête menée par le Consortium. Composé de 8 structures d’études scientifiques, ce Consortium, mis en place par le CEDPE, a réalisé une étude de terrain approfondie dans trois pays - le Tchad, la République Centrafricaine (RCA) et le Cameroun—grâce au soutien financier et technique de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).
Afin de renforcer l’impact de cette initiative et de garantir une meilleure compréhension des enjeux liés à notre mission, nous sollicitons l’appui de toutes les parties prenantes pour continuer ce travail essentiel.
Je vous remercie.
Conclusion
Les crises liées à l'eau, comme la sécheresse ou les inondations, incitent les populations à se déplacer vers d'autres régions pour mieux vivre. Cela peut provoquer des déplacements internes ou des migrations transfrontalières, avec des conséquences socioéconomiques et politiques.
La promotion de la coopération régionale sur la gestion des ressources en eau, l'amélioration de la gouvernance et l'investissement dans des infrastructures durables revêtent une grande importance. Pour atténuer les impacts, il est essentiel d'adopter des approches intégrées qui prennent en compte le lien entre le climat, la migration et la sécurité.
Enfin, nous appelons les partenaires étatiques et non étatiques à soutenir l’élargissement, l’approfondissement et l’amélioration de l’enquête menée par le Consortium. Composé de 8 structures d’études scientifiques, ce Consortium, mis en place par le CEDPE, a réalisé une étude de terrain approfondie dans trois pays - le Tchad, la République Centrafricaine (RCA) et le Cameroun—grâce au soutien financier et technique de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).
Afin de renforcer l’impact de cette initiative et de garantir une meilleure compréhension des enjeux liés à notre mission, nous sollicitons l’appui de toutes les parties prenantes pour continuer ce travail essentiel.
Je vous remercie.
[[1]]url:#_ftnref1 (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects : Highlights. ST/ESA/SER.A/423).
[[2]]url:#_ftnref2 UNOCA, 2020.
[[3]]url:#_ftnref3 Les directions, les distances et les périodes de migration des pasteurs varient suivant les pays et les périodes.
[[4]]url:#_ftnref4 Sougnabe, 2003.