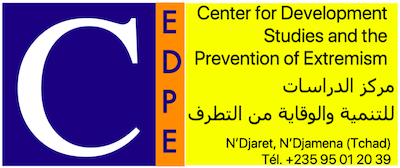Les récentes tragédies survenues à Mandakao et Assonga rappellent douloureusement que les conflits intercommunautaires restent une plaie béante au cœur du Tchad. Face à ce fléau, le silence ou l’inaction ne sont plus acceptables. Le Centre d’Études pour le Développement et la Prévention de l’Extrémisme (CEDPE) a eu raison d’appeler à une mobilisation urgente, en particulier autour d’un acteur trop souvent marginalisé : la société civile.
Les associations, les leaders communautaires, les organisations de jeunesse et de femmes sont les premières sentinelles de la cohésion sociale. Leur enracinement dans les réalités locales leur permet de comprendre les dynamiques profondes des tensions, d’identifier les signaux d’alerte, et de tisser des ponts là où les divisions menacent. Pourtant, ces forces vives demeurent négligées, privées de moyens, parfois instrumentalisées à des fins partisanes.
Il est temps d’inverser la tendance. L’État tchadien a une responsabilité historique : reconnaître le rôle stratégique de la société civile dans la construction d’une paix durable, et lui donner les moyens de remplir cette mission. Cela passe par un cadre légal protecteur, un appui financier transparent, et une véritable autonomie d’action. Sans cela, les efforts de prévention resteront vains.
La paix ne peut être imposée par décret. Elle se cultive, patiemment, dans les esprits, dans les écoles, dans les marchés, dans les villages. Donnons à la société civile la place qu’elle mérite. Pour que les larmes versées à Mandakao et Assonga ne soient pas vaines. Pour que le Tchad retrouve enfin le chemin du vivre-ensemble.